La Guerre d’Espagne (3)
La
question de la terre dans le cadre de la lutte de classe du prolétariat espagnol
(«programme communiste»; N° 107; Mars 2024)
INTRODUCTION
Nous présentons
ici un résumé introductif des travaux sur le problème de la terre dans le
cadre de la lutte de classe du prolétariat espagnol, c’est-à-dire les
problèmes allant de la composition sociale d’un prolétariat majoritairement
situé dans les zones agraires jusqu’à la structure même de l’économie
agricole espagnole et à la portée de la crise économique dans celle-ci en
tant que catalyseur des tensions sociales qui, de manière latente ou
explicite, s’étaient accumulées depuis le milieu du XIXe siècle.
Cette esquisse
fait suite à ce qui a déjà été publié sur programme communiste. Nous
la présentons sous forme de thèses générales qui servent à situer le
problème dans la perspective marxiste (et donc à réfuter les lieux communs
des opportunismes de tous bords) ou à critiquer explicitement les prétendues
positions de gauche, qui s’appuient sur l’existence de minuscules formations
au programme vaguement et éclectiquement antistalinien, pour revendiquer une
sorte de voie nationale espagnole au bilan des très durs affrontements de
classe des années 1930. Pour notre part, aborder maintenant, bien que
partiellement et sans l’objectif d’épuiser le problème, la dite question
agraire, signifie continuer à préciser de façon détaillée les termes dans
lesquels cette prétendue gauche espagnole n’a pas existé en tant que courant
assimilable à la Gauche italienne dans son effort pour restaurer les bases
correctes du marxisme, prémisse incontournable pour la réapparition, dans un
avenir qui semble encore lointain, du parti communiste qui aura à se
confronter aux tâches des futures convulsions révolutionnaires (dans
lesquelles il est certain que la question agraire ne constituera pas un
problème mineur).
Cette étude
fait donc non seulement partie des travaux déjà « semi-élaborés » par notre
courant depuis plus de 60 ans, mais elle adopte aussi une caractérisation
que nous pouvons appeler in medias res, dans la mesure où nous lui
fixons des limites formelles, pour commencer, dans une période spécifique
(celle de la plus grande intensité de la lutte prolétarienne dans les
campagnes espagnoles) dans le seul but de clarifier à la lumière de cette
intensité des tendances et des formes qui, en période de paix sociale, sont
floues et difficilement compréhensibles. Mais il ne faut pas perdre de vue
que cette clarté n’a de valeur que si elle contribue à démontrer que le
marxisme est non seulement capable de poser correctement tous les problèmes
du développement historique, économique et social espagnol (ce que nient
aussi bien les courants poststaliniens que les anarchistes) mais qu’il est
la clé de voûte pour pouvoir les résoudre tous dans un sens prolétarien et
communiste lors des futures convulsions sociales que le monde capitaliste
porte en lui et qu’il laisse déjà entrevoir.
Concrètement,
la question de la terre abordée au moment où les armées de prolétaires des
campagnes sont jetés dans la bataille contre un ennemi composé dans une
large mesure de petits propriétaires terriens organisés et encadrés par les
capitaines propriétaires, et par lequel ils ont été vaincus, montre les
conditions dans lesquelles la solution au problème séculaire des campagnes
espagnoles va s’opérer par sa disparition pratique dans les conditions où
elle existait pratiquement depuis les guerres civiles de Castille (XIVe et
XVe siècles).
Le saut
définitif vers l’industrialisation s’est fait en Espagne sur la base de
cette défaite et il ne peut s’expliquer qu’en partant de la base qui fournit
la répression d’une force de travail vaincue et humiliée.
Il n’est pas
nécessaire de souligner l’importance pour les marxistes de la question
agraire. Il est très probable que dans les œuvres de Marx et d’Engels, il se
trouve plus de pages consacrées à ce problème qu’à celui de l’industrie. Il
en va de même pour l’œuvre de restauration du marxisme révolutionnaire de
Lénine, et il n’est pas nécessaire de parler de l’effort que notre courant
lui a consacré tant du point de vue strictement économique que dans ses
rapports avec des problèmes aussi vastes que celui des nationalités, la
lutte des peuples dits de couleur, ou le bilan de la révolution russe
elle-même. On peut aussi dire, en guise d’explication négative, que le peu
ou l’absence d’importance que pratiquement tous les courants politiques
prétendument révolutionnaires accordent aujourd’hui à cette question est
déjà révélateur de la grande pertinence qu’elle continue d’avoir. Mais même
ainsi, il est nécessaire de montrer comment son importance a déterminé
chacun des événements de la période étudiée. Une importance qui, en raison
de son éloignement temporel ainsi que du grand effort de falsification et de
caricature dont elle a fait l’objet, peut parfois paraître peu claire dans
ses termes concrets.
Nous profitons
donc de l’occasion pour revenir sur une explication de la nature de la
guerre civile qui a été si souvent répétée qu’elle est maintenant
communément acceptée : le coup d’État militaire, initialement promis à un
triomphe rapide qui l’aurait placé dans la série interminable des
pronunciamientos militaires espagnols, s’est transformé en guerre civile en
raison de la résistance opposée par les prolétaires dans les principales
villes du pays. La défaite initiale de l’armée dans tous les centres urbains
névralgiques a contraint les capitaines rebelles à mobiliser toutes les
ressources militaires dont ils disposaient pour entamer une guerre de siège
des villes résistantes.
Nous avons
nous-mêmes utilisé cette explication du début de la guerre ; elle est
cependant partielle car elle laisse de côté pratiquement la moitié du
problème. En effet la guerre, comprise comme une guerre de positions dans
laquelle deux armées au potentiel similaire se sont affrontées pendant trois
ans, n’aurait pas été possible si, en plus de la réponse au coup d’Etat
donnée par le prolétariat de Barcelone, Madrid et Valence, il y avait eu une
réponse similaire du prolétariat agraire (et de la masse des petits
propriétaires agricoles qui lui sont liés) d’Andalousie, d’Estrémadure et,
en partie, de Castille. En effet, une fois les militaires putschistes
vaincus à Barcelone et à Madrid (et isolés à Valence), les forces rebelles
n’avaient pratiquement plus de troupes sur la péninsule ibérique. La
carte 1 montre que les forces militaires, bien qu’elles dominassent plus
ou moins la moitié de la péninsule, n’avaient pratiquement pas de centres
industriels (essentiels pour une guerre prolongée) et étaient, en fait,
coincées entre les villes qu’elles ne parvinrent pas à contrôler et qui se
retournèrent rapidement contre elles. En résumé, on peut dire que les
rebelles ne contrôlaient que les grandes régions de Castille, où la base
sociale est essentiellement constituée par la petite paysannerie aisée, le
bastion réactionnaire de Navarre, où une paysannerie prospère est le pilier
de la préservation sociale depuis 1830, et la région peu peuplée de Galice,
où l’absence de concentration prolétarienne empêchait toute résistance au
coup d’État. La zone contrôlée par les militaires se caractérisait donc par
une faible densité de population, de petits noyaux ruraux et uniquement des
villes de taille moyenne par rapport à celles qui échappaient à leur
contrôle. Si des villes comme Grenade, Séville ou Cordoue étaient entre
leurs mains, c’est parce qu’il s’agit de villes à majorité sociale
bourgeoise ou petite bourgeoise qui servent de tête de pont commerciale pour
les vastes zones agricoles environnantes. La vaste étendue de territoire
allant de Madrid à la Méditerranée, zone dominée par les grands
propriétaires terriens et dont la composante prolétarienne est purement
agricole, était ingérable pour les rebelles dans les premiers jours de la
guerre.
Voyons
maintenant la carte 2, qui montre les positions des deux camps dans
les premiers jours de septembre (c’est-à-dire à l’arrivée des forces armées
à Madrid). Qu’est-il arrivé ? Il s’est passé que toute la partie occidentale
de la péninsule (Andalousie occidentale et Estrémadure) est tombée aux mains
des rebelles en l’espace de quelques mois. La partie de l’armée dirigée par
Franco et Queipo de Llano avance depuis la région du Maroc espagnol,
débarque sur la côte méditerranéenne de la péninsule et se dirige vers le
sud de Madrid. Pendant ce temps, la zone contrôlée par le général Mola
(Navarre, nord de la Castille, etc.) n’évolue guère, ses troupes n’ayant pas
réussi à s’approcher de Madrid et étant généralement immobilisées par la
pression des colonnes de miliciens de la capitale et de Barcelone.
Ces cartes
montrent la zone des agitations agraires pendant la période de la Seconde
République (carte 3) et la répartition des terres par type de
propriété (carte 4). On constate que les militaires ont avancé
précisément dans la zone où le type d’exploitation agricole est
essentiellement latifundiste, ce qui, comme nous l’expliquerons, implique la
présence d’une importante couche sociale de prolétaires agricoles
(journaliers) mélangée à d’autres couches sociales agraires qui subsistent
grâce au travail agricole de type métayage et qui, extrêmement appauvries,
s’étaient mobilisées aux côtés des prolétaires pendant la période de la
République. En d’autres termes, les militaires ont avancé dans les zones les
plus conflictuelles de la campagne espagnole, pour lesquelles la stérile
réforme agraire républicaine avait été conçue et dans lesquelles le degré de
syndicalisation était le plus élevé. Nous expliquerons en temps voulu le
développement du conflit prolétarien dans ces régions du pays, mais pour
l’instant il suffit de dire que si les prolétaires de ces zones avaient été
mobilisés selon un plan cohérent contre les militaires, le sort de ces
derniers aurait été le même que celui de leurs compagnons d’armes de
Barcelone ou de Madrid.
Cet exemple,
donné pour expliquer la pertinence de la question agraire dans la guerre
civile et qui fait appel à sa composante sociale, peut être conclu en
complétant l’affirmation faite ci-dessus :
Le coup d’État
militaire initialement destiné à un triomphe rapide qui le placerait dans la
série sans fin des pronunciamientos militaires espagnols s’est transformé en
guerre civile en raison de la résistance opposée par les prolétaires dans
les principales villes du pays. La défaite initiale de l’armée dans presque
tous les centres urbains névralgiques a obligé à mobiliser toutes les
ressources militaires dont disposaient les capitaines rebelles pour lancer
une guerre de siège contre les villes « non rachetées » ou irrédentes, et
ces forces n’auraient pas été suffisantes si elles avaient été confrontées à
la masse des prolétaires agricoles qui séparaient les légionnaires et les
troupes arabes du Maroc de Madrid tout au long du sud et de l’est de la
péninsule. Le coup d’Etat a été arrêté par la classe prolétarienne des
villes, mais la guerre a été rendue possible par la démobilisation du
prolétariat agricole dans les campagnes.
Avant de
conclure cette introduction, clarifions un point et tirons quelques
conclusions :
- L’avancée des
militaires dans les campagnes espagnoles était une obligation militaire et
non politique. C’est-à-dire que cette situation ne peut être assimilée à
celle vécue en Italie dans les années 1920, lorsque les milices fascistes
s’attaquaient d’abord aux forces prolétariennes des campagnes parce qu’elles
étaient plus faibles que celles des villes contre lesquelles se préparait
l’attaque finale. En Espagne, le passage du Maroc à Madrid, objectif premier
de la victoire, impliquait la traversée des campagnes d’Andalousie et
d’Estrémadure, mais l’objectif des rebelles n’a jamais été de supprimer
d’abord les noyaux prolétariens de l’Est et du Sud pour accumuler des forces
avant le siège de Madrid. Seule l’attaque de Badajoz, qui n’est pas sur la
route de Madrid et où se concentraient les prolétaires de la région et ceux
qui avaient fui devant l’attaque des troupes d’Afrique, pouvait avoir ce
sens compte tenu de la terrible répression subie dans cette ville
d’Estrémadure.
- C’est la
nécessité de nettoyer le terrain conquis par les troupes venues du Maroc qui
a transformé le caractère social du coup d’État : d’une opération éclair qui
devait se solder par quelques milliers de morts, on est passé à une guerre
de répression systématique.
- Cette même
situation modifia non seulement la prépondérance militaire de certains
capitaines sur d’autres (Franco sur Mola, essentiellement), mais aussi le
programme politique même du soulèvement, qui s’éloigna de la vision initiale
d’un mouvement de maintien de l’ordre pour devenir un programme de
réorganisation du système politique espagnol (voir le document de Mola).
- La prétendue « révolution prolétarienne » qui se serait produite dans la zone républicaine n’en a jamais été une, puisqu’elle n’a même pas évoqué la possibilité de se répercuter dans les zones de plus grand conflit agraire. Les dirigeants du POUM, de la CNT et de la FAI ont abandonné sans hésitation les prolétaires des campagnes en soutenant la politique de l’Etat républicain.
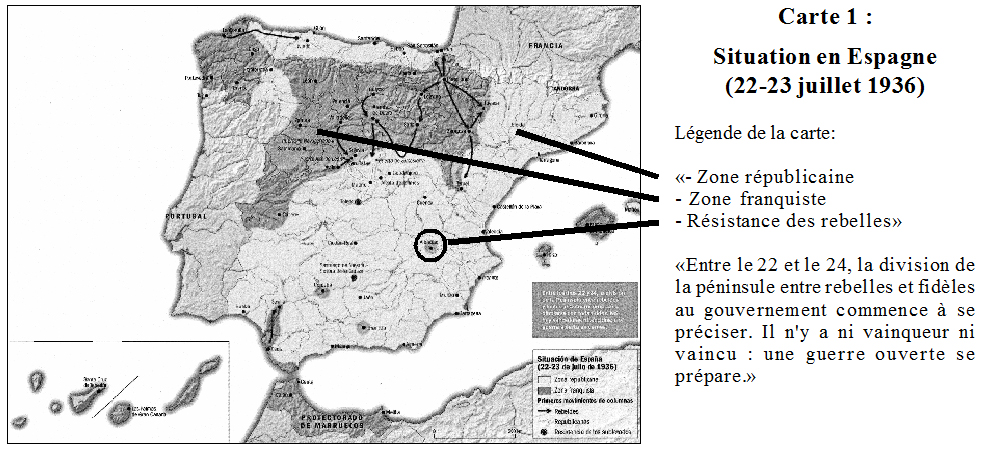
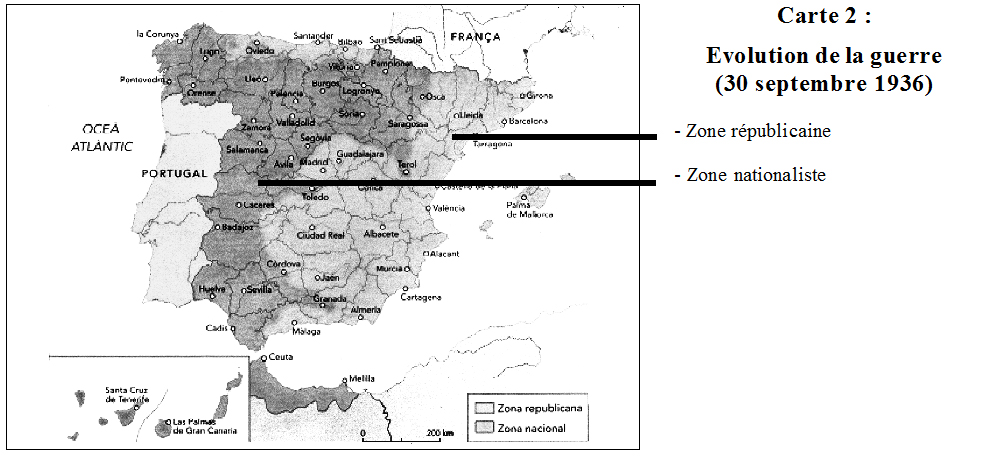
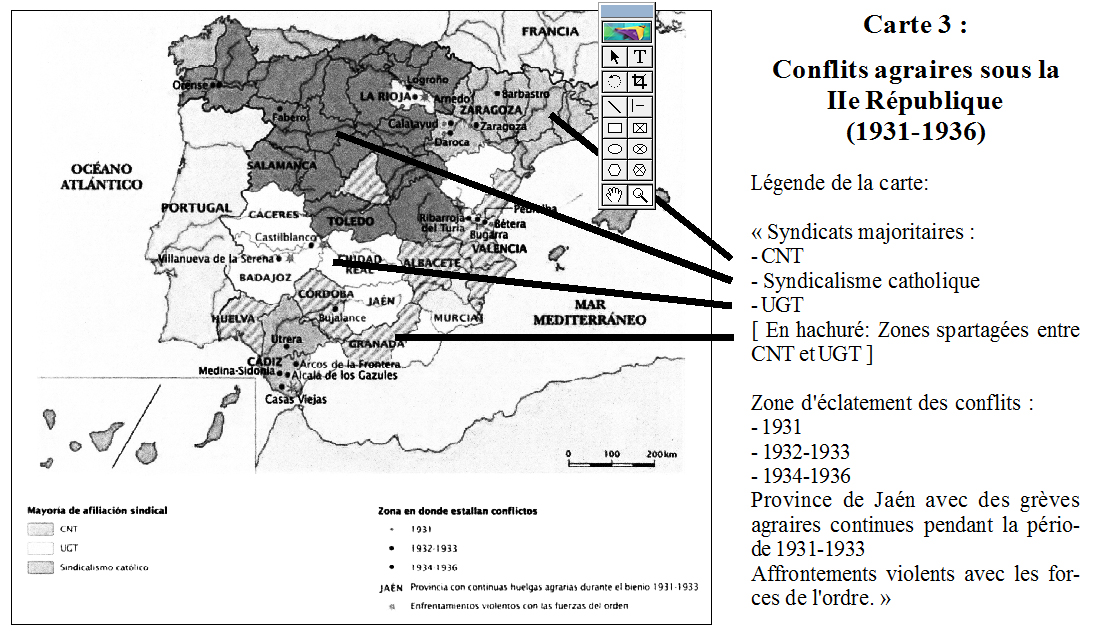
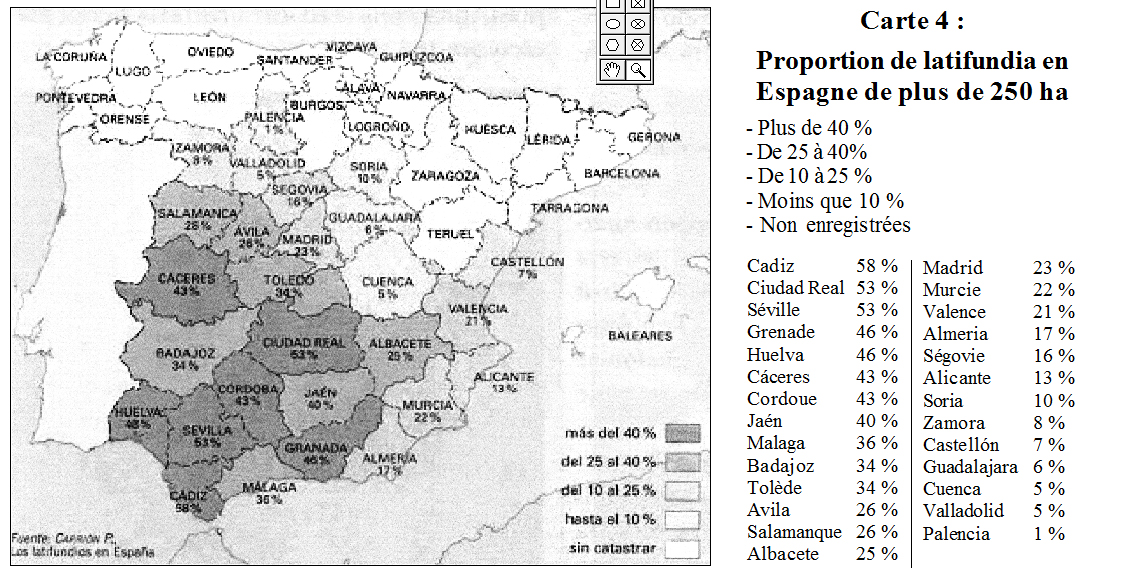
1. Quelques points fondamentaux
des positions marxistes sur la question
agraire
Rappelons ces
points clés de la doctrine qui nous permettent de nous orienter dans le
cours du développement agraire espagnol et qui donneront lieu, à leur tour,
à une explication ultérieure de la signification des agitations agraires qui
l’ont secoué jusqu’aux années de la guerre civile.
Une thèse tout
à fait erronée est que le marxisme, face au problème de la terre, identifie
la grande propriété à un mode de production capitaliste pleinement développé
dans les campagnes et la petite propriété à un mode de production archaïque,
féodal, sous-développé, etc. Au fond, cette thèse est redevable d’une autre,
plus générale, plus vaste et donc erronée dans l’absolu, qui rattache le
marxisme exclusivement à une critique des formes de propriété en vigueur
sous le capitalisme. Selon ce
postulat, la propriété privée des moyens de production est le facteur
déterminant de l’émergence du capitalisme et de son développement, et il est
tout à fait secondaire qu’elle se fasse avec ces moyens de production,
comment elle se passe, et pour qui. Appliquée à la question agraire, cette
façon d’aborder le problème voit dans l’extension de la petite paysannerie,
des agriculteurs et, en général, de la petite propriété agraire, précisément
une multiplication de la propriété privée qui non seulement éloigne la terre
de sa socialisation possible en augmentant le nombre de ses propriétaires,
mais entraîne aussi des inefficacités économiques résultant de la
sous-utilisation des ressources productives existantes.
Il s’agit d’une
vision a-historique de la nature du capitalisme, qui ne s’attarde que sur
les aspects superficiels de son expression sociale et qui est totalement
incapable d’aborder des problèmes tels que la question agraire. La
caractéristique essentielle du capitalisme est l’appropriation privée des
fruits du travail associé, et cela ne provient pas de l’apparition de la
propriété privée, mais de l’évolution technique des moyens de production, du
développement de la division du travail, des progrès scientifiques appliqués
à la structure productive de sociétés où la propriété privée prédominait
déjà et sur lesquelles aucun grand changement n’est intervenu dans l’aspect
de la propriété.
Concrètement,
dans l’agriculture, pour ce qui est de la question de la propriété foncière,
le capitalisme se fonde sur l’existence de la propriété privée de grandes
étendues de terre qui coexistent avec des propriétés petites et moyennes,
mais qui s’en distinguent par le fait qu’elles constituent, dans une large
mesure, la base du pouvoir économique des seigneurs. Les latifundia, les
grands domaines fonciers, etc., sont les formes de propriété foncière non
seulement du mode de production féodal, mais aussi de formes économiques
antérieures comme l’esclavage ou le despotisme asiatique. Dans ces formes,
la propriété de la terre au moins, et généralement aussi d’une grande partie
des moyens de production, est donc pleinement développée. A côté de cela,
même dans les modes de production précapitalistes, existent de petites
propriétés qui jouent un rôle relativement mineur dans la société de
l’époque, et des formes de propriété communale qui, elles, tendent
irrémédiablement à s’éteindre.
La
caractéristique du mode de production féodal, pour ne parler que de celui
qui précède immédiatement le capitalisme en Europe, n’est donc pas la
propriété privée de la terre, comme elle ne l’est pas non plus dans le
capitalisme, mais le fait que la force de travail utilisée entretient une
relation de servitude à l’égard des grands propriétaires terriens.
La révolution
bourgeoise, le passage du mode de production féodal au mode de production
capitaliste, dont c’est un jalon définitif, n’implique donc pas un
changement essentiel dans le fait qu’il existe une propriété privée de la
terre et des moyens de production. Les classes possédantes, avec plus ou
moins de variations dans leur composition organique, traversent ce
changement en adaptant et en modifiant les relations de vassalité qu’elles
entretiennent avec leurs subordonnés sociaux ou, dans le cas extrême de la
France, en disparaissant en grande partie et en voyant leurs biens répartis
entre les paysans qui accèdent au rang de propriétaires terriens.
La petite
propriété agricole peut en effet apparaître comme une caractéristique
possible de la domination capitaliste ; c’est-à-dire qu’elle peut constituer
une étape favorable au développement du capitalisme dans le monde agricole
et, donc, à la maturation des conditions nécessaires à sa transformation
socialiste. C’est pourquoi opposer une forte concentration des propriétés
foncières à la propriété de petites parcelles de terre impliquerait de faire
du monde féodal une étape plus proche du socialisme que le capitalisme. A la
racine de cette erreur il y a l’incompréhension de la nature des forces
sociales qui sont en jeu quand le monde féodal disparaît devant la pression
des rapports productifs capitalistes, fait qui peut ou non culminer dans une
révolution bourgeoise, mais qui aboutit en tout cas à l’arrivée au pouvoir
de la bourgeoisie, que ce soit par la voie révolutionnaire directe ou par la
voie indirecte d’un accommodement avec les anciennes classes dominantes.
Dans ce passage, la vieille propriété nobiliaire-féodale disparait avec les
formes juridiques qui la soutenaient : amortissement des terres, vassalité,
servitude, ordonnances municipales, etc. Cela ne le fait pas tant parce que
le développement des forces productives dans les campagnes l’exige, mais
parce que le développement industriel dans les villes, conséquence de
l’accumulation progressive des changements dans l’organisation du travail,
dans la science et la technologie, rend obsolète l’ensemble des rapports de
propriété existants. Le capitalisme a besoin de travailleurs libres dont il
peut tirer de la valeur ajoutée parce qu’ils sont libres de vendre leur
force de travail. Cela se vérifie essentiellement dans les villes où
l’industrie a dorénavant dépassé la phase féodale de l’artisanat, mais pas
dans les campagnes où les méthodes de culture traditionnelles n’ont pas
changé de manière significative. C’est ce besoin qui le pousse à abolir les
anciens rapports de propriété, ce qui implique de donner la liberté
personnelle aux anciens serfs mais pas nécessairement de liquider les
latifundia et les grands propriétaires. Si la paysannerie entre en scène
dans cette révolution, si elle constitue son corps social dans les campagnes
(cas français ou russe) ou non (cas espagnol), cela détermine la profondeur
et l’ampleur du changement dans le milieu agraire.
Partout
où cela se produit, la lutte des paysans est toujours pour la distribution
de la terre, pour l’abolition de la propriété privée traditionnelle de la
terre et pour le passage à un nouveau type de propriété privée qui implique
le morcellement, la distribution de la terre en petites parcelles, mais
surtout la libre disposition de la terre par la famille paysanne. Et même
cette nouvelle formule s’accompagne presque toujours de la survivance de
l’ancienne propriété, développée en fonction des temps nouveaux sous des
formules telles que le métayage, le fermage, etc. Là où cela ne se produit
pas, là où la paysannerie féodale, pour une raison ou pour une autre, comme
ce fut le cas en Espagne, ne se soulève pas contre ses seigneurs, le passage
au monde bourgeois dans les campagnes se fait sans grands changements dans
la structure de la propriété : le paysan libre travaillera pour le seigneur
en échange d’une rente (en nature ou en argent), sans aucun changement dans
la distribution des terres et en adoptant seulement le contrat légal à la
place de la dépendance personnelle coutumière comme lien entre les seigneurs
et les paysans.
La grande
propriété foncière, quand elle se maintient en conséquence de l’absence de
révolution agraire, bien qu’elle soit une propriété bourgeoise de droit et
de fait, ne constitue aucun avantage comparatif d’un point de vue communiste
sur la voie du dépassement du régime capitaliste à la campagne et à la
ville, dans la mesure où elle n’implique pas automatiquement l’émergence
d’un prolétariat agricole pleinement formé, mais tend à maintenir des formes
intermédiaires d’exploitation qui ne font que repousser la nécessité de
cette révolution.
Mais, peut-on
argumenter, les bases matérielles de la lutte de classe du prolétariat et de
son développement dans un sens communiste (prise du pouvoir, exercice de la
dictature, intervention despotique dans l’économie, transformation
socialiste du mode de production) apparaissent avec la concentration
industrielle, avec la formation d’armées de travailleurs libres partageant
des conditions de vie similaires, organisées par cette concentration, dont
le principe est l’expropriation de la petite propriété. En quoi l’apparition
d’une petite propriété agricole est-elle un avantage par rapport au maintien
de grands domaines fonciers ? La grande propriété industrielle se
caractérise par le développement de la division sociale du travail rendue
possible par les améliorations techniques de la production. Avec cette
division sociale du travail, celui-ci prend une caractéristique sociale et
non plus individuelle ; tous les travailleurs acquièrent la qualité commune
d’être des producteurs, à l’inverse de toutes les caractéristiques
individuelles engendrées par le travail de l’artisan. La grande entreprise
suppose une grande concentration de moyens de production techniquement
supérieurs à ceux utilisés par le petit propriétaire et la conversion de
tout travail individuel en travail social homogène.
Il saute aux
yeux que dans le domaine agricole, il n’y a rien de tel avec la grande
concentration de la propriété foncière. Pratiquement, du point de vue de sa
productivité, de l’utilisation de ressources techniques, etc., la grande
propriété terrienne est comparable à une petite entreprise : le travail
d’ensemble de la main-d’œuvre employée se présente comme une somme de
travaux individuels qui ne produit pas d’avantages d’échelle, qui n’augmente
pas exponentiellement les performances et qui, par conséquent, maintient des
particularismes, des formes individuelles, etc. Alors qu’un million d’unités
monétaires investies dans une grande entreprise industrielle ne correspond
pas à mille entreprises industrielles dans lesquelles seraient investis le
millième dans chacune, mais constituent une entreprise exponentiellement
plus grande que ces mille, mille hectares de propriété, répartis selon un
modèle de métayage le plus homogène possible, font un millier de petites
entreprises. C’est le type d’exploitation économique du travail associé et
non le type de propriété qui définit le capitalisme et, par conséquent, qui
crée les bases de son dépassement socialiste. Et le type d’exploitation du
travail caractéristique du capitalisme n’apparaît dans l’agriculture que
dans une proportion bien moindre que dans l’industrie. Le fait qu’au début
du mode de production capitaliste le système de production agraire
correspondait, soit à un système de grande concentration de propriété
subdivisée en parcelles exploitées selon des régimes de semi-dépendance,
soit à un système de petites propriétés directement comparables aux petites
entreprises industrielles, indique seulement que le capitalisme est
incapable de générer dans les campagnes le progrès économique qu’il génère
dans les villes.
La différence
essentielle entre la grande et la petite propriété ne réside pas dans la
capacité productive de l’une par rapport à l’autre, mais plutôt dans le fait
que, sous le système de la propriété terrienne, la révolution agraire est
inachevée et l’apparition de rapports sociaux bourgeois sur le terrain ne se
produit qu’après un très long processus au cours duquel la revendication
première des masses exploitées continue d’être la propriété individuelle de
la terre et avec cela l’apparition d’une classe prolétarienne pure
assimilable à la classe prolétarienne industrielle tarde à se produire. Au
contraire, là où la révolution bourgeoise a été soutenue par une révolution
agraire, la masse des paysans petits bourgeois devenus propriétaires de la
terre peut plus rapidement déclencher les phénomènes d’intensification de la
production, de concentration agraire, etc., accélérant l’émergence du
prolétariat agricole et la création des bases de la lutte des classes dans
les campagnes.
2. Espagne :
disparition de la propriété féodale, amortissements et réforme agraire
La grande importance de la question agraire dans les événements tragiques
des années 1930 en Espagne réside dans le développement particulier du mode
de production capitaliste depuis le XIXe siècle.
Tout d’abord, il faut préciser qu’il n’y a jamais
eu en Espagne un mode de production typiquement féodal : le vassalisme et la
servitude n’existaient que dans certaines régions de la péninsule, car les
conditions exceptionnelles de la guerre continue contre les Arabes ont
favorisé l’émergence d’une classe de paysans libres, fondée sur la propriété
individuelle de la terre et l’exploitation des biens communs (pâturages,
forêts, etc.) sur une grande partie du territoire frontalier de cette
guerre. Pourtant, la carte de l’Espagne se caractérise par une grande
diversité de types de propriété, allant de l’accaparement, de l’emphytéose
et de la petite exploitation à la grande propriété foncière. Si l’on ajoute
à cela des conditions physiques et climatiques très disparates entre les
différentes parties du territoire, ce qui implique de grandes différences en
termes de productivité, il en résulte d’immenses contrastes entre régions,
dont certaines peuvent être assimilées aux petites propriétés apparues en
France après la Révolution de 1789 et présentant d’autres particularités
importantes difficilement assimilables à d’autres pays européens.
Sans entrer dans la genèse médiévale des
propriétés agricoles, nous nous concentrons sur le moment clé du
développement agricole du pays : le bouleversement social qu’impliqua le
rejet de l’invasion française. C’est à ce moment que se rompt l’équilibre
social traditionnel qui avait été maintenu entre la noblesse qui se plaçait
sous la protection de la monarchie absolue et les forces bourgeoises
progressistes qui avaient établi leur fief dans les communes espagnoles. La
défection des premières devant l’envahisseur et la poussée populaire qui
oblige les secondes à diriger une révolte non seulement contre les armées
napoléoniennes, mais aussi contre l’Ancien Régime, se heurtèrent aux Cortes
de Cadix en 1812. Là, les représentants d’une bourgeoisie urbaine peu
nombreuse sous la pression d’une ville assiégée et en pleine effervescence,
mais ayant besoin de l’appui de la petite noblesse qui luttait aussi contre
l’envahisseur, votèrent ce qui sera la législation de référence en matière
agraire pendant plus d’un siècle. En résumé, les Cortes de Cadix déterminent
l’abolition des seigneuries juridictionnelles et le maintien des seigneuries
territoriales. Cela signifiait que les paysans et les terres devenaient
libres, c’est-à-dire les premiers non soumis à la dépendance personnelle (ce
qui s’exprimait généralement en termes économiques) et les deuxièmes
amortissables, aliénables, transférables sans tenir compte des droits de
majorité, de primogéniture, etc. Mais cela signifiait aussi que la propriété
foncière était remise aux seigneurs qui en avaient été les chefs
juridictionnels. La formule était la suivante : à partir de la liberté
individuelle et de l’instauration d’une propriété de type bourgeois comme
celle que nous venons d’expliquer, celle-ci incomberait à qui aurait des
droits historiques sur elle. Inutile de dire que ni les communes ni les
paysans ne pouvaient faire valoir de tels droits face aux anciens seigneurs,
seuls ces derniers demeurant donc propriétaires là où il y avait des doutes.
La propriété privée de la terre demeura donc inchangée, à la différence que
les paysans devinrent formellement des travailleurs libres (nous disons
formellement parce que, comme nous l’avons dit plus haut, il n’y eut en fait
pas de servitude généralisée des paysans au seigneur, sauf dans très peu de
régions du pays, la dépendance étant consacrée sous forme de paiements en
nature, d’impôts, etc.) Nous pouvons résumer ainsi la carte de la propriété
agricole en Espagne en tenant compte des relations sociales qui existaient
avant l’indépendance :
- Zone andalouse, où les grandes étendues
territoriales étaient la norme, pratiquement expropriation totale des
paysans. Apparaît la propriété foncière capitaliste consacrée à la culture
du blé et de l’orge.
- Zone de la
Manche et sud de la Castille jusqu’au Tage, où, exactement comme en
Andalousie, persistent les grandes étendues territoriales dédiées au blé et
à l’orge.
- Zone
castillane jusqu’au Douro, les grandes étendues appartenant à la noblesse et
l’église cohabitent avec les petites propriétés agricoles.
- Zone
navarraise, prédominance des petites exploitations caractérisées par leur
grande fertilité.
- Galice, de
grandes propriétés avec un système de baux qui accorde pratiquement la
propriété foncière aux paysans qui se consacrent au maïs, à la pomme de
terre et à d’autres cultures plus rentables que les céréales.
- Aragon et
Catalogne, prédominance de petites propriétés combinées avec quelques-unes
plus étendues mais loin des grands latifundia du sud.
- Zone côtière
du nord (Asturies, Pays basque, Cantabrie), petites propriétés plus centrées
sur l’élevage.
- Levant,
mélange de petites et grandes propriétés dédiées à la culture d’arbres
fruitiers.
Ainsi, les lois de Cadix, qui survécurent aux restaurations absolutistes
successives, déterminèrent deux traits essentiels de la campagne. Tout
d’abord, la création d’un substrat paysan qui ne pouvait subsister avec ses
petites propriétés une fois que les grandes qu’il travaillait habituellement
étaient devenues la propriété des seigneurs. Deuxièmement, le caractère
aliénable de la terre, qui permettra sa lente concentration entre quelques
mains et l’ascension d’une classe de petits propriétaires au statut de
grands propriétaires terriens comparables aux nobles qui détenaient
traditionnellement la propriété.
L’importance de ces deux facteurs sera mise en
évidence lors de l’événement suivant, caractéristique de l’évolution du
problème de la terre en Espagne : les « désamortissements ». En se
concentrant sur les deux les plus caractéristiques, celui de Mendizábal en
1830 et celui de Madoz en 1855, le processus peut se résumer comme suit : la
faillite du Trésor public, qui se détachait de la Couronne et devenait une
partie essentielle de l’État bourgeois naissant, empêchait l’État lui-même
d’entreprendre les travaux publics (chemins de fer, routes, etc.)
nécessaires au développement capitaliste. Il est donc procédé à la vente des
terres dites amorties, c’est-à-dire celles qui appartenaient aux communes
sous forme de terres communales et celles qui appartenaient aux ordres
religieux. En conséquence, la source de revenus de nombreux petits paysans
(les terres communes) disparut et un processus de concentration agraire
démarra en Andalousie, la Manche, le sud de la Castille et l’Estrémadure,
qui a abouti à la carte agraire définitive qui sera perceptible jusqu’aux
années 1950. La carte 4
permet d’observer le résultat en termes de
concentration de la propriété agricole
Dans l’ensemble, ce processus de concentration de la propriété n’a pas
abouti à la création d’entreprises modernes en termes capitalistes : le
faible rendement des terres sur lesquelles la concentration avait lieu a
entraîné la faiblesse des investissements en capital ; les méthodes de
culture (trois feuilles) ou de non-culture de vastes étendues de terre
(dédiées à la chasse ou au pâturage), les moyens de production limités (la
charrue à traction humaine était encore courante en raison du manque
d’animaux) caractérisaient des exploitations très arriérées.
Mais à la place, un phénomène très caractéristique
se produisit, surtout en Andalousie : l’émergence d’une grande couche
sociale de paysans qui non seulement ne possédaient pas un seul hectare de
terre en propriété, mais ne travaillaient pas non plus celui de leur
seigneur en termes de baux. Il s’agit des fameux journaliers, qui
constituèrent la majorité de la main-d’œuvre des régions andalouse et de la
Manche donnant naissance à un prolétariat purement agraire qui jouera dès
lors un rôle déterminant dans les troubles ruraux. Dans d’autres régions
d’Espagne, comme l’Estrémadure ou l’intérieur du Levant, il y eut des cas
semblables, comme celui des Junteros,
travailleurs qui possédaient les jougs pour unir les bœufs mais pas un seul
pouce de terre et aucun animal, s’assimilant pratiquement aux prolétaires
journaliers. Cette grande masse sociale prolétarienne sera la clé d’une
constante ébullition dans la campagne, mais aussi la clé de la création d’un
prolétariat urbain dans la région de Catalogne qui conservera très vivantes
les traditions de lutte qu’il avait connues dans le sud du pays.
On ne peut passer sous silence un autre phénomène, à savoir la persistance
d’un petit paysan aisé qui a survécu avec une petite parcelle en propriété
et grâce à l’exploitation des terres communales. Surtout dans la région de
Navarre, cette paysannerie se retrouva à la fois dans les rangs de la
réaction absolutiste pendant les guerres civiles carlistes et dans les
armées de Mola pendant la guerre civile.
Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la structure
agraire espagnole s’était consolidée telle qu’elle durera jusqu’au Plan de
Stabilisation de 1959, avec la transformation des vieilles classes
seigneuriales en nouvelles classes de propriétaires terriens semi-bourgeois
(la fameuse oligarchie agraire)
qui seront la principale force sociale du pays jusqu’aux années 30. Là où la
campagne était plus productive, cette voie « junker » de l’évolution agraire
présentait moins de faiblesses dans la mesure où elle atténuait les tensions
sociales et permettait la survie de petites exploitations agricoles qui
atténuaient la misère de la paysannerie. Là où la monoculture céréalière et
oléicole était prédominante, les limites de la rentabilité ont été
rapidement atteintes malgré les mesures protectionnistes et les crises
agricoles successives furent particulièrement dures. L’absentéisme foncier,
le manque d’investissements en capital, la sous-utilisation des terres,
etc., engendrèrent des tensions sociales qui n’ont pu être apaisées que
lorsque les armées putschistes de 1936 ont occupé ces régions. Un corps
mi-policier et mi-militaire comme la Garde civile, créée spécialement pour
réprimer les classes populaires paysannes, donne une idée de l’importante
tension qui existait autant que des émeutes successives qui ont éclaté
jusqu’au début des années de la République.
Le troisième point à traiter dans ce paragraphe,
la Réforme agraire de la IIe République, a déjà été commenté dans les pages
de Bilan
dans les années 1930. Comme on le sait, il s’agissait d’un programme
d’expropriation des terres de certains grands propriétaires moyennant une
indemnisation pour les répartir entre les journaliers sans terre ou entre
les paysans qui n’en possédaient que de petites parcelles. L’objectif
n’était pas tant d’accroître la rentabilité de la production agricole que de
contenir une tension sociale croissante. L’objectif de la réforme agraire
peut être défini comme une tentative de liquider la lutte sociale qui
menaçait d’éclater définitivement dans une grande partie de l’Espagne en
créant une couche de paysans aisés, perméables aux intérêts petits bourgeois
d’autres couches sociales, et à partir de laquelle un plan d’investissement
public pourrait être mis en œuvre pour accroître la productivité de
l’agriculture espagnole.
Comme c’était inévitable, la réforme se heurta au
fait que c’était la classe bourgeoise espagnole elle-même qui possédait la
plus grande partie des terres et que l’image du seigneur féodal absentéiste
de ces terres et étranger à la classe bourgeoise relevait du mythe plus que
de la réalité. Le programme d’expropriation petit-bourgeois se heurta aux
exigences de la grande bourgeoisie qui réclamait que ces expropriations se
fassent sans toucher à leurs terres. Ainsi, la réforme elle-même fut conçue
comme un plan tel qu’il aurait fallu au moins 150 ans avant qu’une partie
substantielle des journaliers accède à la propriété foncière. Le grand
projet républicain, qui se voulait une partie substantielle de la
république des travailleurs de toutes les classes
définie par la Constitution de 1931, fut mort-né et il ne réussit qu’à
anéantir les espoirs des prolétaires sans terre dans la République.
Une période d’agitation sociale en milieu rural, beaucoup plus dure que les
précédentes, a alors éclaté.
3. L’agitation sociale à la campagne au cours des années 1931-1936
Pour
caractériser l’agitation sociale dans la campagne pendant cette période, il
est important de préciser un fait fondamental : le développement de la
production agricole, marqué comme nous l’avons souligné par la fin de
l’attachement des paysans à la terre et par les confiscations du XIXe
siècle, a donné lieu, à la fin de ce même siècle, à la formation de
relations sociales purement capitalistes dans une grande partie des
campagnes espagnoles. Les grandes propriétés du sud de l’Espagne étaient
exploitées pour la plupart par des prolétaires purs, c’est-à-dire par des
travailleurs ruraux qui ne possédaient pas de terres propres et qui vivaient
sur la base de contrats avec les propriétaires terriens ; Les petites
propriétés du centre-nord de la péninsule se comportaient dans des termes
similaires, employant une moindre quantité de main-d’œuvre mais le faisant
également dans un rapport salarial ; enfin, des propriétés de taille moyenne
apparaissent dans tout le pays, pouvant coexister avec de grandes
concentrations de terres travaillées en métayage (foros, rabassa morta,
etc.)
En ce sens, il
est important d’expliquer un point que nous avons évoqué dans la première
section de ce résumé : la faible productivité agricole n’est pas une
caractéristique exclusive des modes de production précapitalistes ; c’est
aussi la réalité des exploitations agricoles bourgeoises qui, même si elles
sont à des années lumières des entreprises industrielles en termes de
performances économiques, sont déjà plongées dans des relations sociales
typiquement capitalistes. Si, en Espagne, la structure de la propriété n’a
pas fondamentalement changé au cours de la période étudiée au-delà de
l’émergence d’une classe de nouveaux petits et moyens agriculteurs, on ne
peut pas déduire de la continuité dans le domaine de la propriété juridique,
une continuité dans le type de production. Le cas le plus singulier est
celui de la moitié sud du pays. Dans cette zone, celle qui comptait la plus
grande concentration de propriétaires fonciers (voir carte 4),
on assiste tout au long du XIXe siècle à un mouvement de junkerisation
du développement agricole, c’est-à-dire de maintien de la propriété entre
les mains de l’ancienne noblesse, convertie en une oligarchie foncière et
infiltrée par une grande partie de la nouvelle grande bourgeoisie rurale,
qui, peu à peu, prit en charge la transformation capitaliste des
exploitations agricoles. Le régime de la Restauration (comme on appelle le
retour des Bourbons sur le trône après la période révolutionnaire de
1868-1874 et l’instauration du bipartisme) reposait sur le pacte entre
l’oligarchie foncière et les classes industrielles des principales villes.
Dans une sorte de symbiose économique, les intérêts de la production
céréalière à grande échelle se conjuguaient parfaitement avec ceux de
l’industrie textile catalane naissante, donnant naissance aux pactes
tarifaires de la fin du XIXe siècle, tandis que ceux de la production
d’olives s’alliaient à ceux qui représentaient le capital industriel basque.
Les grandes extensions agricoles de la moitié sud du pays firent également
valoir leurs intérêts purement bourgeois dans la formation d’un État qui
représentait leurs besoins.
Mais
du côté des paysans, ce processus a été sanglant : à la perte
initiale des terres qu’ils cultivaient pour le seigneur et sur lesquelles
ils avaient certains droits de permanence, s’ajoutait la perte des terres
communales qui leur permettaient de subsister. Cette double pression,
caractéristique de l’évolution de la campagne espagnole par la voie
Junker, déboucha sur des émeutes agraires qui éclataient périodiquement,
créant la base sociale du républicanisme d’abord et du syndicalisme agraire
ensuite. Les soulèvements de Malaga dans les années 1840, de Jerez dans les
années 1880, véritables insurrections paysannes, répondaient à la transition
de la paysannerie vers sa conversion en un prolétariat complètement privé de
tout moyen de vie autre que la vente de sa force de travail, phénomène
saisonnier et soumis aux fluctuations économiques qui ont déterminé les
crises agraires de la fin du XIXe siècle. C’est précisément après ces
grandes agitations que les courants anarchistes commencèrent à s’organiser
et à imprégner les campagnes de la moitié sud du pays, diffusant un
programme collectiviste et immédiatiste tant sur le plan politique
qu’économique (et même « militaire »), qui gagna une bonne partie des
nouveaux prolétaires. Nous ne nous attarderons pas à réfuter l’idée d’un
prétendu millénarisme congénital à la paysannerie ou d’un ADN libertaire
parmi les habitants du sud de la péninsule ; mais nous ne pouvons manquer de
souligner que le prolétariat rural écrivit les pages les plus dures de
l’affrontement contre la bourgeoisie à une époque où le prolétariat urbain
n’était encore qu’une petite force.
De tout ce que
nous venons de dire, il faut retenir que les agitations agraires dans la
moitié sud de l’Espagne, où elles furent les plus nombreuses, avaient un
caractère purement prolétarien, tant par leur organisation (sous forme
syndicale) que par leur contenu (qui rejeta, dès le début du XXe siècle, la
répartition individuelle des terres comme solution). Il est vrai qu’il y a
eu d’autres types d’agitations dans des régions comme la Catalogne, où le
régime du métayage établi selon le principe de la rabassa morta (les
paysans possédaient la terre et les vignes jusqu’à leur mort, date à
laquelle le contrat de fermage était renouvelé) créa une classe de fermiers
pauvres mais non prolétaires, qui avaient un caractère typiquement paysan,
c’est-à-dire qui avançaient la revendication du partage des terres des
grands propriétaires entre les familles paysannes. Et il est vrai que le
conflit que cette classe, assimilable à la petite bourgeoisie, entretenait
avec le pouvoir central fut une source d’instabilité continuelle tout au
long de la période républicaine. Mais le véritable poids social, durant
cette période, reposait sur les prolétaires d’Andalousie, d’Estrémadure et
de Castille-la-Manche ; le rôle qu’ils jouèrent au cours des années 1930 fut
décisif tant dans le déclenchement de la guerre civile que dans son
développement.
En
fait, comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, la mesure la
plus urgente à instaurer dès le gouvernement républicain provisoire
(1931-1932) dirigé par les partis conservateurs, fut la réforme agraire qui
devait affaiblir la force des latifundia du sud en donnant lieu à une
répartition des terres entre les journaliers. La réponse de ces journaliers
à la chute de la monarchie ne se fit pas attendre. Dans un contexte où la
crise économique, qui en Espagne fut dans une large mesure une crise
agricole, fit des ravages, condamnant pratiquement la moitié de la main
d’œuvre agricole au chômage forcé, l’occupation des terres pour leur culture
collective commença quelques jours à peine après l’instauration de la
république. Surtout dans la région de l’Andalousie occidentale, les
journaliers prirent l’initiative d’abattre les clôtures des terres non
cultivées appartenant à la bourgeoisie agraire pour les mettre en
exploitation. Ce fut d’ailleurs la raison de la tentative de coup d’État de
Sanjurjo en 1932, qui eut lieu précisément à Séville, où la Guardia Civil
apparaissait comme la seule garantie possible des grands propriétaires qui
voyaient leurs intérêts en danger. Et c’est dans ce contexte que
s’expliquent des événements comme celui de Casas Viejas, une agglomération
de la région de Cadix, où après une grève générale manquée, les journaliers
se barricadèrent dans leurs quartiers et furent massacrés par la Guardia
Civil sur ordre du très républicain Azaña, champion des partis de gauche.
La virulence de
la mobilisation prolétarienne dans la moitié sud de l’Espagne ne signifie
pas qu’elle était absente dans d’autres régions. En fait l’ensemble du
prolétariat agricole se lança dans des luttes partielles pour des
revendications salariales en affrontant non seulement les grands
propriétaires terriens, mais aussi ceux qui possédaient de petites parcelles
de terre et qui employaient une main-d’œuvre salariée saisonnière. Comme
fait révélateur de cette extension de l’agitation, on peut signaler la mise
en place de syndicats ouvriers traditionnels dans des régions où ils
n’avaient jamais eu d’implantation auparavant, comme en Aragon, où la classe
des salariés était minoritaire par rapport aux petits propriétaires. Mais
c’est dans les régions andalouses, d’Estrémadure et de La Manche que la
lutte prolétarienne atteignit sa plus grande intensité.
De manière
générale, on peut caractériser cette lutte de la façon suivante :
1.
Comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’une lutte typiquement paysanne :
en raison de son contenu et de ses formes d’organisation, les prolétaires
ruraux se présentaient comme une classe qui combattait indépendamment des
autres, entraînant derrière eux y compris une bonne partie des petits
propriétaires qui n’avaient pas recours au travail de journaliers.
2.
Outre la réforme agraire, les gouvernements républicains essayèrent de
mettre en œuvre un vaste système d’instruments de conciliation sociale
capables d’amortir la lutte des classes dans les campagnes. C’est ainsi que
furent mis en place des « jurys mixtes », organismes de médiation entre les
employeurs, les syndicats et l’État, qui cherchaient à résoudre les conflits
du travail sans recourir à la grève. Un système de subventions fut également
institué pour fournir du travail aux chômeurs, etc. En général, la pression
du prolétariat rural faisait que ces mécanismes de conciliation entre
classes jouaient toujours en faveur de leurs intérêts immédiats,
généralisant la hausse des salaires, etc. C’est contre ce système, qui
favorisait les prolétaires dans la mesure où ils disposaient d’une force
réelle acquise par la lutte, mais qui cherchait à saper cette force en la
contrôlant par des mécanismes démocratiques, que la bourgeoisie rurale se
dressa, ne voyant, comme toujours, que ses pertes immédiates. La répression
sanglante qui suivit le coup d’État fut dirigée à la fois contre les forces
syndicales et politiques et contre les représentants des institutions
démocratiques que la République avait implantées dans le monde rural
(enseignants, fonctionnaires, etc.)
3.
L’anarchisme était la force politique dominante parmi les journaliers depuis
la fin du XIXe siècle et, par conséquent, les anarchistes furent à la tête à
la fois des affrontements salariaux avec les propriétaires terriens et des
mobilisations semi-insurrectionnelles. Les conséquences de cette orientation
furent néfastes pour les prolétaires. Même si les affrontements avec la
bourgeoisie agraire et ses forces répressives furent très durs lors des
grèves, ils n’ont jamais eu, même dans les moments de plus grande
mobilisation, un objectif clair, les dirigeants anarchistes se contentant
d’indiquer une vague « collectivisation » immédiate des terres (à
l’intérieur des communes) comme objectif final et donc gaspillant
l’incroyable force ouvrière qui se manifestait au cours de ces années.
Malgré l’existence d’un syndicat, la CNT, qui regroupait les prolétaires des
campagnes et des villes, les deux
secteurs restaient pratiquement déconnectés l’un de l’autre ; on peut
constater combien les phases d’apogée de la lutte dans les campagnes
correspondaient à des moments de dépression de la lutte dans les villes et
vice versa, sans qu’aucune offensive commune n’ait jamais lieu.
4.
Le courant
socialiste, organisé en syndicat au sein de l’UGT, avait moins de force
parmi les prolétaires ruraux. Sa politique de collaboration avec la
dictature de Primo de Rivera la désavoua aux yeux d’une grande partie de ces
prolétaires, mais la politique de subventions accordées par le gouvernement
socialiste-républicain renforça peu à peu ses positions dans la mesure où il
devint gestionnaire de ces subventions. La direction du PSOE-UGT maintint
comme position fondamentale le respect absolu de la légalité républicaine,
cherchant précisément à renforcer les mécanismes de médiation que celle-ci
mettait en place et soumettant la lutte immédiate des prolétaires à la
défense du programme agraire des différents gouvernements. Ce n’est qu’après
l’arrivée au pouvoir de Lerroux en 1934 et l’inclusion comme ministres des
membres du CEDA ( parti qui représentait les grands propriétaires terriens)
que la pression de la classe ouvrière força l’UGT à adopter une position de
confrontation avec le gouvernement, même si les implications sur le terrain
pratique furent impuissantes, comme ce fut le cas pour les anarchistes, lors
de l’imposant mouvement de grève de juin 1934.
5.
La très forte vague de grèves et d’occupations de terres (surtout alors en
Estrémadure) qui suivit la victoire du Front Populaire en février 1936 créa
un climat pré-insurrectionnel en Espagne. La légalité républicaine était
complètement dépassée et ne pouvait sanctionner qu’après coup les
occupations de terres des grands propriétaires. Seul le coup d’État
militaire fut capable d’arrêter l’extension du conflit. Comme on le sait, la
réponse ouvrière dans les villes au soulèvement des généraux entraîna la
défaite de la plupart d’entre eux et cela dans les endroits clés (Barcelone,
Valence, Madrid, etc.) Le poids des prolétaires organisés dans la CNT et
dirigés concrètement par la FAI fut décisif. Mais qu’en fut-il à la
campagne ? Les régions où les mobilisations des journaliers avaient été les
plus intenses (Estrémadure et Andalousie occidentale surtout) restèrent aux
mains de ces mêmes journaliers, tandis que les forces bourgeoises se
renforcèrent dans des villes comme Séville grâce à l’extraordinaire
concentration de la Guardia Civil et des militaires qui étaient sur place
précisément pour combattre les prolétaires.
Le prolétariat
rural donne alors l’impression d’être une armée démobilisée : il contrôle le
territoire, mais ne reçoit ni l’encadrement militaire ni la direction
nécessaires pour achever d’écraser l’ennemi.
À
Barcelone, pendant ce temps, les dirigeants de la FAI acceptent de respecter
le gouvernement régional républicain de la Generalitat, affirmant ne pas
disposer de suffisamment de forces pour le combattre. A Madrid, ils
rejoignent directement le PSOE et les Républicains dans un front unique. Les
socialistes, les anarchistes et bien sûr les staliniens laissent au
gouvernement l’initiative de mobiliser la classe prolétarienne des
campagnes, seul garde-fou contre l’avancée des troupes franquistes venant
d’Afrique. Plus craintive des prolétaires que des militaires, la République
démobilise les prolétaires maîtres des villes de la région, les appelle à ne
pas résister, leur refuse les armes... En novembre 1936, quatre mois après
le début de la guerre, Madrid est assiégée depuis le sud, les troupes de
Franco ayant parcouru huit cents kilomètres sans aucune résistance, tandis
que les organisations syndicales des prolétaires ruraux ont été détruites et
que la répression est menée de manière particulièrement sadique contre les
journaliers.
6. L’oubli du prolétariat des campagnes et des zones insurgées a été une des clés de la défaite. La division entre les camps « national » et « républicain » brisa la solidarité de classe, laissant le prolétariat espagnol à la merci de la réaction des deux côtés.
Parti Communiste International
Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program
www.pcint.org